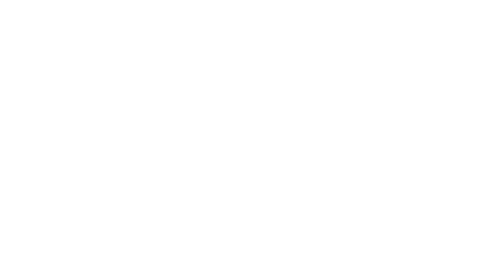L’étrange cas du syndrome d’Irak
Après la guerre du Vietnam, une génération de dirigeants américains a développé ce qui est devenu connu sous le nom de «syndrome du Vietnam» – une croyance pathologique selon laquelle le soutien public à l’usage de la force était trop éphémère et le pouvoir de l’armée américaine trop incertain pour que des opérations militaires étrangères soient recommandées. . Ce syndrome a tourmenté la prise de décision américaine pendant des années, mais au milieu des années 1980, son pouvoir avait commencé à décliner. La rapide victoire des États-Unis dans la guerre du Golfe en 1991 aurait semblé la bannir définitivement. Mais en réalité, le succès de l’opération Desert Storm a renforcé l’idée que le public ne tolérerait que des conflits de courte durée et à faible nombre de victimes.
Les inquiétudes concernant le syndrome du Vietnam sont revenues lorsque le président américain George W. Bush s’est préparé à envahir l’Irak en 2003. Bush est allé de l’avant quand même, et la guerre qui en a résulté a été la plus importante et la plus coûteuse que les États-Unis aient menée depuis les années 1970. Bien que l’invasion ait initialement bénéficié d’un soutien public considérable, sa popularité a décliné lorsqu’elle ne s’est pas déroulée comme prévu. En quelques années, l’administration Bush a fait face à la perspective très réelle de perdre, et seule la décision politiquement controversée de changer de stratégie et d’envoyer davantage de troupes et de ressources en Irak a modifié la trajectoire de la guerre. Bush a remis à son successeur, le président américain Barack Obama, une guerre en Irak plus prometteuse qu’elle ne l’avait été en 2006, mais encore loin des prédictions optimistes d’avant-guerre.
Deux décennies après l’invasion initiale, l’Irak reste un projet de sécurité en cours. Comparé à la défaite pure et simple des États-Unis en Afghanistan, le résultat de la campagne américaine en Irak ressemble à un succès modeste. Il pourrait encore être possible d’atteindre certains des objectifs de la guerre – un Irak qui peut se gouverner et se défendre et qui est un allié dans la guerre contre les terroristes – mais à un prix tragiquement élevé. Mais comparé aux attentes des partisans de la guerre, l’Irak ressemble à un fiasco dans le moule du Vietnam. Et le choc a eu le même résultat : les décideurs politiques ont développé le syndrome irakien et croient maintenant que le public américain n’a pas envie d’opérations militaires menées sur un sol étranger.
Le syndrome irakien soutient que les Américains sont phobiques des victimes : ils ne soutiendront une opération militaire que si le coût en vies américaines est insignifiant. En conséquence, les décideurs américains qui souhaitent recourir à la force doivent se battre le moins possible et renoncer rapidement à leurs engagements si l’adversaire se révèle capable de riposter et de tuer des soldats américains. La position politiquement opportune, dans un monde affligé par le syndrome irakien, est une position quasi isolationniste, puisque le public n’est pas disposé à supporter les coûts d’engagements internationaux durables.
Mais aussi répandu qu’il soit parmi les politiciens, le syndrome irakien ne semble pas être aussi répandu parmi le grand public. Les électeurs américains ne sont pas aussi allergiques à la force militaire que le pensent leurs dirigeants. En fait, le public continuera à soutenir adéquatement une mission militaire même si ses coûts augmentent, à condition que la guerre semble gagnable. Cela signifie que les décideurs politiques n’ont pas besoin d’abandonner un engagement de sécurité nationale dès que les coûts commencent à monter, à condition que les dirigeants poursuivent une stratégie qui mènera au succès. Les dirigeants devraient accorder plus d’attention aux perspectives de bons résultats plutôt que d’essayer des engagements gratuits, une norme impossible que le public n’exige pas et qui ne fait qu’entraver l’Amérique dans un monde dangereux.
UN SYNDROME D’ÉLITE
Il ne fait aucun doute que le syndrome irakien est courant dans les cercles politiques. À des moments clés, les présidents américains ont délibérément évité de prendre des décisions similaires à celles prises en Irak. Obama a évité une intervention significative dans la guerre civile syrienne, par exemple, malgré le fait que les coûts humanitaires de rester à l’écart éclipsaient sans doute les coûts de l’invasion de l’Irak. Il a également retardé jusqu’au tout dernier moment toute action énergique contre l’État islamique, ou ISIS, une formidable organisation terroriste qui a rapidement éclipsé Al-Qaïda et menacé de plonger tout le Moyen-Orient dans le chaos en 2015 et 2016.
De même, le président américain Donald Trump, bien qu’il ait parlé en termes belliqueux de la Corée du Nord, de l’Iran et de l’Etat islamique, a pris soin d’éviter les confrontations directes avec les deux premiers et s’est empressé de déclarer victoire, puis de réduire les opérations, contre le troisième. Le président américain Joe Biden a également été sensible aux critiques selon lesquelles le soutien américain à l’Ukraine pourrait se transformer en un engagement illimité des forces américaines « comme l’Irak », et il a été scrupuleux quant à la limitation de l’implication américaine au partage de renseignements et à la fourniture d’armes. Dans tous les débats politiques depuis l’élection présidentielle de 2004, les colombes ont eu l’avantage, toujours prêtes à affirmer que toute démonstration de la puissance militaire américaine pourrait devenir un autre Irak.
Mais si les politiciens et les décideurs sont clairement affligés, il y a moins de preuves que le grand public a attrapé le syndrome irakien. Pour commencer, même pendant la guerre en Irak, le public n’était pas phobique des victimes. Contrairement aux attentes de beaucoup, le public américain a largement fait des évaluations raisonnées et raisonnables de la guerre. Certes, le soutien public a quelque peu chuté à mesure que le nombre de morts augmentait, mais ces fluctuations dépendaient davantage des attentes quant à l’issue finale de la guerre. Quand il semblait que les États-Unis pourraient gagner, le public était prêt à continuer la guerre. Lorsqu’il semblait que les États-Unis pourraient perdre, les pertes se sont avérées beaucoup plus corrosives pour le soutien du public. Même après que l’opinion publique ait changé et que la plupart des Américains aient commencé à voir l’invasion comme une erreur, il n’y a pas eu de demandes généralisées pour un retrait brutal. Le Parti républicain a perdu des sièges lors des élections de mi-mandat de 2006 en partie à cause de l’Irak, mais Bush a néanmoins été en mesure de rassembler un soutien politique suffisant pour mettre en œuvre la poussée.
Les sondages suggèrent que le public américain fait des compromis raisonnés lorsqu’il décide de soutenir ou non le recours à la force.
Le public s’est également montré étonnamment tolérant envers la poursuite de l’engagement militaire américain en Irak et en Afghanistan pendant le mandat d’Obama. Bien qu’il ait fait campagne contre la guerre, Obama a rapidement abandonné son plan d’abandonner immédiatement l’Irak, suivant initialement le calendrier de retrait conçu par Bush. Obama a finalement abandonné ce calendrier, décidant de quitter complètement l’Irak en 2012 plutôt que d’y maintenir une petite force comme prévu à l’origine. Mais il n’a payé qu’un petit prix politique lorsqu’il a de nouveau inversé sa trajectoire et renvoyé des troupes de combat en Irak pour aider à combattre l’EI en 2014. Pour sa part, Trump n’a fait face à aucune pression publique significative pour arrêter la campagne contre l’EI et a reçu relativement peu de publicité. mérite d’avoir déclenché la sortie américaine d’Afghanistan.
Les sondages suggèrent que plutôt que de s’opposer par réflexe à la guerre, le public américain fait des compromis raisonnés lorsqu’il décide de soutenir ou non le recours à la force. Les sondages effectués avant et après la guerre en Irak montrent que la volonté du public de payer le coût humain de la guerre dépend à la fois de l’importance de la mission pour la sécurité américaine et de la probabilité que la mission réussisse. Par exemple, en novembre 2021, nous avons reproduit une expérience d’enquête que nous avions initialement menée en 2004, qui demandait aux participants s’ils soutiendraient un conflit hypothétique sur la base des informations fournies par les chefs d’état-major interarmées. En 2021, comme en 2004, le nombre probable de victimes et les perspectives de succès ont eu un impact significatif sur le soutien à la mission hypothétique, suggérant que le public américain adopte une approche rationnelle pour peser les coûts et les avantages de l’utilisation de la force militaire.
UN PEUPLE INTERNATIONALISTE
La popularité de Trump peut provenir en partie du sentiment anti-irakien au sein du Parti républicain. Mais l’isolationnisme n’a pas fermement saisi le grand public, qui reste généralement d’orientation internationaliste avec un niveau élevé de confiance dans l’armée, en particulier en comparaison avec d’autres institutions. Selon une enquête Gallup de 2023, 65% des Américains estimaient que les États-Unis devraient jouer un rôle de premier plan ou majeur dans les affaires mondiales – seulement une légère baisse par rapport à février 2001, lorsque 73% des Américains partageaient cette opinion.
De plus, le public américain continue de croire que les forces armées de la nation sont exceptionnelles. Selon un sondage Gallup de 2022, 51% des Américains étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle les États-Unis ont l’armée la plus puissante du monde, la même proportion qu’en 2000. Bien que la confiance populaire dans presque toutes les institutions publiques ait diminué au cours des dernières décennies , la confiance dans l’armée américaine reste élevée. Un autre sondage Gallup en 2022 a montré que 64 % des Américains ont « beaucoup » ou « beaucoup » confiance dans l’armée américaine. C’est légèrement inférieur aux niveaux de confiance exprimés par les Américains dans les années qui ont suivi le 11 septembre, mais similaire aux niveaux qu’ils ont exprimés dans les années 1990 et nettement supérieur à ceux qu’ils ont signalés dans les années 1970 et 1980.
Certains sondages récents montrent une baisse de confiance parmi les républicains, en particulier à la suite des attaques de Trump contre des personnalités militaires de haut rang et des affirmations généralisées selon lesquelles les forces américaines se sont «réveillées». Pourtant, le débat entre faucons pro-défense et isolationnistes anti-militaires au sein du Parti républicain ne s’est guère tranché en sa faveur. Il y a peu de preuves que l’Irak a détourné le public américain des affaires internationales ou a sapé sa confiance dans l’usage de la force à l’étranger.
La guerre en Irak a été un changement radical pour beaucoup de ceux qui ont été directement touchés par le conflit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis. Mais il semble avoir eu moins d’impact sur le grand public américain, qui reste solidement internationaliste, confiant dans la puissance et les institutions militaires de la nation, et capable de faire des compromis raisonnés entre les coûts probables (en particulier le coût humain) et la sécurité potentielle. avantages de l’intervention, ainsi que la probabilité de succès.
Les politiciens qui espèrent gagner le public avec des plateformes isolationnistes pourraient faire un pari perdant. Il est vrai que les décideurs américains ont réagi aux frustrations en Irak de la même manière qu’ils ont réagi à l’échec au Vietnam il y a près de cinq décennies : ils ont continué à s’engager dans des interventions militaires actives mais ont évité les déploiements terrestres à grande échelle. Le syndrome irakien est sans aucun doute réel, mais il peut être ressenti plus intensément parmi les élites que parmi le public. Et tout comme les présidents américains Ronald Reagan et George HW Bush ont trouvé possible de rallier le public derrière des interventions militaires même dans le sillage du Vietnam, Biden ou ses successeurs pourraient trouver le public tout aussi persuasif après l’Irak. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.